Depuis plus de vingt ans, les nouvelles techniques d’information et de communication ont secoué les pratiques du journalisme. En 1990, l’ouverture d’Internet au grand public change le rapport à l’information. Pour cet article, nous avons notamment échangé avec Clémence Leleu, journaliste en presse écrite.
Le numérique a multiplié la vitesse à laquelle les individus ont accès à l’information et les réseaux sociaux deviennent des concurrents pour les médias traditionnels. Pour la professeure Annelien Smets, c’est ce que le chercheur en communication Maxwell McCombs aurait qualifié d’effet de substitution : plus de temps passé sur Facebook signifie moins de temps passé à regarder le JT du soir ou à lire un journal.
En 2007, l’émergence de l’iPhone a creusé un nouveau fossé entre les médias traditionnels, le public, et le journalisme : Steve Jobs a inventé un outil regroupant les fonctions de base du téléphone combinées à un appareil photo, un navigateur internet et, dès 2008, un App Store qui permet de télécharger de nouvelles applications.

Cette innovation est ingénieuse, car elle transforme le public en acteur. Par exemple, lors de l’éclipse solaire de 2015, des citoyens ont relayer l’événement sur les réseaux sociaux. Des médias tels Europe 1 ont utilisé ce type de contenu pour en créer un nouveau. Ici, les journalistes ne sont plus les seuls relais de l’information.
« Les réseaux sociaux permettent aussi aux journalistes d‘avoir une vision plus large et plus précise de certains sujets par le biais des réseaux sociaux, notamment de découvrir de nouvelles sources. Ils peuvent aussi être un moyen pour les journalistes de trouver des témoins pour certains sujets. »
Clémence Leleu, journaliste
En 2009, l’Agence France-Presse (AFP) rejoint Twitter, Youtube, Instagram et Facebook. En 2010, après quelques essais, ce sont Le Monde et Le Figaro qui rejoignent les réseaux sociaux.
L’avancé du domaine en communication représente alors une réelle opportunité, et les médias embauchent des professionnels spécialisés dans l’animation de ces plateformes. Il s’agit d’en utiliser les fonctions pour développer de nouveaux formats, comme, par exemple, le lancement de vidéos courtes et le reportage en direct.

En 2015, Hugo Travers lance sa chaine Hugo Décrypte. En utilisant la plateforme Youtube, il propose un format innovant qui touche de nombreux jeunes. Son statut de journaliste est toutefois questionné, souvent qualifié d’influenceur.
« Ce n’est pas parce que des personnes se sont faites connaître sur les réseaux et y ont trouvé une audience que ce sont des influenceurs. [..] Nous ne pouvons plus ne cantonner que les gens qui sortent d’école de journalisme comme des « vrais » journalistes ou encore ceux travaillant pour des médias dits traditionnels. »
Clémence Leleu, journaliste
En 2016, c’est le média français Brut, qui se démarque réellement grâce à sa couverture sur la campagne des élections américaines. Brut aborde des sujets progressistes et s’appuie sur un récit émotionnel, ce qui l’aide à renforcer son identité et à instaurer une relation de proximité avec son audience.
Cependant, sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à la désinformation. Les utilisateurs participent au débat public en commentant, partageant et en réagissant aux contenus qu’ils voient. Mais, qui garantit que leurs propos sont corrects ?
En 2020, la désinformation liée au COVID fait du bruit. Des messages racistes envers des personnes d’origine chinoise, et des fake news sur les vaccins avaient inondé les réseaux sociaux. Dans cette interview à Loopsider, Thérèse Sayarath explique que ces fake news ont augmenté le taux d’agressions envers la communauté asiatique.
Thérèse Sayarath y décrit son choc face à la Une du quotidien régional d’Amiens, Courrier picard, titrée « Coronavirus Chinois : Alerte Jaune. » Cela évoque la responsabilité des journalistes dans leur rédaction, mais également les biais racistes qui y sont véhiculés, de manière consciente ou inconsciente.
Peut-on donc encore croire ce que nous disent les médias et les journalistes ? C’est une question légitime du public face à ces dérives, qui illustre sa perte de confiance envers la presse.
« Les journalistes ne sont qu’une partie des garants de la vérité […] ils sont garants d’une « information vérifiée et sourcée ». Mais les citoyens ont aussi un rôle important à jouer, ne pas se cantonner à une seule source d’information journalistique, essayer de les multiplier, afin d’élaborer leur propre avis sur certains sujets. »
Clémence Leleu, journaliste
Les innovations du numérique, comme l’Intelligence Artificielle ont accéléré le débat sur l’état du journalisme. Face à ChatGpt et d’autres outils de l’IA, le journaliste a-t-il encore sa place ? En février 2025, Eric Barbier, journaliste à L’Est républicain, confiait à France 3 qu’il s’inquiétait de ce qu’allait devenir son métier face à ces outils.
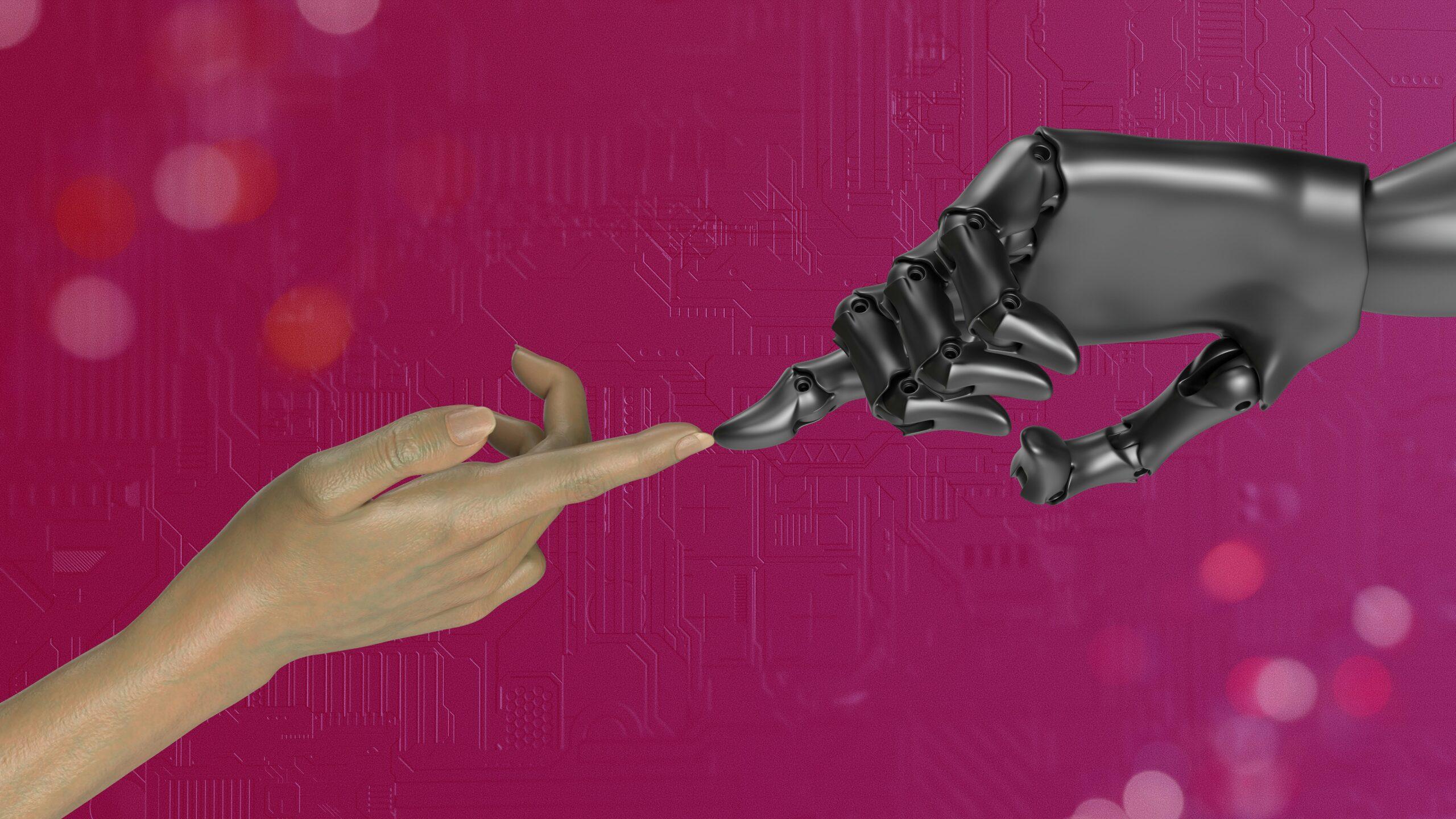
« On s’inquiète beaucoup à l’idée que des articles courts, ceux qui alimentent le flux ou servent le référencement, puissent désormais être rédigés par des IA. Soit, mais est-ce vraiment là que les journalistes trouvent le plus de sens à leur métier ? Probablement pas. L’arrivée de l’IA nous invite surtout à repenser la façon dont nous valorisons les professionnels de l’information, ainsi que la nature des missions qui leur sont confiées. Elle peut être l’occasion de redonner toute leur place aux journalistes, dans un secteur qui, depuis des années, ne cesse de se fragiliser. »
Clémence Leleu, journaliste
Autre bémol : utiliser l’IA pour créer des fake news. Brigitte Macron a d’ailleurs été la cible de plusieurs d’entre elles : accusations d’être une femme transgenre, et plus récemment, d’avoir harcelé sexuellement un ancien étudiant lorsqu’il avait 12 ans. Cette dernière fake news a été diffusée sous un format vidéo, en volant l’identité d’une vraie personne.
Autant de questions qui renvoient essentiellement à la source : elle occupe une place centrale dans le débat et doit être vérifiée et restituée dans son contexte pour assurer un journalisme éthique et professionnel.
Les autres articles de la série sur l’histoire du journalisme.
Bonus : la reco média d’une bénévole – par Chloé
Touristes, le podcast. Ce podcast vaut le détour pour le hasard merveilleux de la vie qu’il représente. Marie et Maxime sont spontanés, à l’aise au micro, et on se sent tout de suite appartenir à une complicité vraie. On découvre à chaque épisode un invité qui parle de son rapport au voyage. Leur enthousiasme est communicatif et donne envie de partir, loin.
Cet article t'a plu ? Tu aimes Exprime ? Soutiens-nous en faisant un don !


 par
par 


